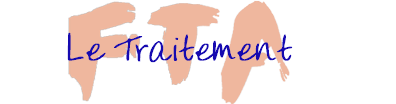LE TRAITEMENT
MARTIN CRIMP & CLAUDE POISSANT / THÉÂTRE PÀP (QUÉBEC)
TRAITEMENT DE CHOC
Trafic d’expériences vécues pour voyeurs
avides de télé-vérité, tel est LE TRAITEMENT de
choc que réserve au 11e Festival de théâtre des Amériques
l’auteur anglais Martin Crimp. Dans cet univers mercenaire, où
l’art se vend et s’achète sur le bitume multiculturel de
New York, se rencontrent une quinzaine de personnages étranges et fascinants.
Claude Poissant, qui depuis vingtcinq ans au Théâtre PàP
affectionne les écritures alliant à une prise de parole une
forme insolite et nouvelle, a trouvé en cette oeuvre, dont il signe
la traduction et la mise en scène, un terrain de jeu idéal et
exaltant. Coproduit par Festival de théâtre des Amériques,
ce spectacle dont l’auteur n’a encore jamais été
joué au Québec sera présenté à l’Espace
GO du 27 au 30 mai 2005.
NOUVEAU MONDE
Rien de nouveau ne lui est étranger. Rien de neuf ne lui fait peur.
Claude Poissant est un Amerigo Vespucci toujours prêt à embarquer
des matelots dans la conquête d’un nouveau territoire théâtral.
Lui qui s’est fait Ventriloque et Goûteur, qui a réussi
l’Unity canadienne et transformé son Théâtre PàP
en un magnifique Hôtel des horizons accueillant tous les survenants
de notre dramaturgie, nous invite à nouveau à partager une découverte,
qui a pour nom Martin Crimp. Né en 1956, cet auteur joué ici
pour la première fois appartient à la jeune génération
du théâtre anglais. Il a déjà écrit une
quinzaine de pièces, jouées à Londres et à New
York, en Allemagne, en Hollande, en France et en Italie, a traduit Molière
et Marivaux, Koltès, Genet et Ionesco pour les scènes britanniques.
Cet homme doux est l’inverse exact de ses personnages, qui parlent vite
et beaucoup, sans parvenir à communiquer. «Plus tu parles, moins
je te comprends», réplique même l’un d’eux.
«Mes personnages, précise-t-il, communiquent, mais de manière
fausse.» Aussi Martin Crimp est-il peut être avant tout un musicien.
«La musique est un bon moyen de communication émotionnelle, parce
qu’il n’y a pas de mots. C’est tentant d’écrire
avec cela en tête. Mais c’est impossible.»
LE FIN MOT DE L’ÉNIGME
Si Bach se situe à ses yeux au-dessus de tout, il admire aussi Beckett
et Pinter, «même s’ils sont tentés de regarder en
arrière, du côté de la mémoire, alors que je désire
que mes pièces avancent, parlent d’un monde où les gens
changent de famille, de job, de sexualité, d’identité.»
L’auteur est tenté de comparer son travail d’écriture
à la stratégie adoptée par les Indiens des films de notre
enfance, quand ils décrivaient des cercles concentriques autour des
cow-boys pour les attaquer. Avec cette volonté d’expérimenter
de nouvelles formes et cette manière de construire en creux ses personnages,
il revendique pour ses pièces un non-dit, qui nécessite du spectateur
l’apport d’une part de lui-même pour compléter l’image
proposée. À l’opposé du sentiment qui se dégage
de son écriture, le scénario du Traitement est construit en
prenant pour point de départ une situation qui paraît ne contenir
aucun mystère, un enjeu connu où tout est joué d’avance.
Et pourtant… La découverte de l’Amérique –
Martin Crimp a situé et daté Le Traitement : New York, 1990.
Des producteurs de cinéma engagent des inconnus pour les écouter
raconter leur histoire. Un trafic d’histoires vraies pour des voyeurs
avides de télé-vérité. Toutefois, les producteurs
se définissent autrement : ils sont «les facilitateurs qui établissent
des connexions». Ils sont «une micropuce à laquelle ils
donnent l’énergie, tandis que les gens fournissent les données».
Les deux producteurs, Jennifer et Andrew, engagent donc Anne, qui semble avoir
à dire des choses intéressantes. Mais celle-ci est hésitante
et se referme. L’auteur convoque d’autres «donneurs de données»
dans sa comédie syncopée : un ancien dramaturge, Clifford, obsédé
de voyeurisme, un chauffeur de taxi, un acteur noir, John, qui, lui, va prendre
en main le film, va le mettre en scène, éjectant ainsi Anne.
Une pièce à l’action hasardeuse et disloquée que
ce Traitement, une oeuvre à deux tranchants, tantôt terre à
terre dans l’approche des cinéastes et des liens entre les personnages,
tantôt irréelle avec ce chauffeur de taxi aveugle-né,
clone d’OEdipe dans un New York tonique et déjanté. Fruit
d’un séjour en résidence dans la Grosse Pomme, Le Traitement,
qui se veut être aussi le portrait d’une ville, s’ouvre
sur la confession d’une jeune femme témoignant des sévices
que lui a fait subir un psycho-killer. Cette histoire, les producteurs la
pervertiront, n’auront de cesse de la ramener à une parole déjà
connue. Si l’héroïne ne survit pas à l’aventure
de vendre l’histoire de sa vie, son destin est avant tout symbolique
de l’incapacité de notre société du spectacle à
rendre compte du
réel.
Arpenteur de l’inconnu
L’état de vertige dans lequel nous entraîne l’auteur
étant le moteur même de son propos, la charge revient à
Claude Poissant de nous le restituer. Associé depuis plus de vingt
ans à la création et au développement de la dramaturgie
québécoise, toujours fidèle à sa volonté
de partager avec le public des écritures différentes et percutantes,
Claude Poissant a permis de connaître quantité d’auteurs
d’ici et d’ailleurs parmi lesquels Geneviève Billette,
François Godin, Isabelle Hubert, François Archambault, François
Létourneau, Kevin Kerr, le Norvégien Knut Hamsun et le Japonais
Kôbô Abe. Découvreur patenté, qui sait transformer
en forces vives de notre théâtre de jeunes acteurs naissants
mais déjà debout, il poursuit avec passion et un constant appétit
de désordre sa démarche consistant à «faire à
sa tête, cultiver son jardin d’instinct, flairer la délinquance…».
Grand directeur d’acteurs, soucieux de maintenir l’union des anciens
et des modernes, Claude Poissant, avec infiniment de justesse et de délicatesse,
sait s’emparer du réel pour le laver de ses clichés et
le tirer vers une transparence qui n’exclut ni la fantaisie ni le fantasme.
Texte : Martin Crimp;
Traduction et mise en scène : Claude Poissant ;
Scénographie : Jean Bard;
Costumes : Linda Brunelle;
Lumière : Éric Champoux;
Musique: Nicolas Basque;
Chorégraphie : Dave St-Pierre
Distribution : Amélie Chérubin-Soulières, Francis Ducharme,
Félix Beaulieu-Duchesneau, Marie-Thérèse Fortin, Catherine
Larochelle, Widemir Normil, Gilles Renaud, Catherine Trudeau, Peter Batakliev
Production : Théâtre PàP. Coproduction : Festival de théâtre
des Amériques
27, 28, 29 et 30 mai 2005
À l'Espace GO
En français

Photos © Yanick MacDonald