

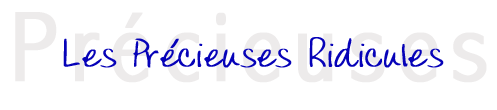
Sous la plume accérée de Molière, il n'y a pas de ridicules que les valets fanfarons et les bourgeois bien-pensants: femmes savantes et autres précieuses n'ont qu'à bien se tenir! Deux petites provinciales, qui contrefont bien maladroitement les manières des grandes dames, débarquent à Paris en quête de princes charmants et de succès mondains. Programme ambitieux et risqué! Méprisant deux honnêtes prétendants qui se proposent de les épouser, elles succombent aux charmes tapageurs de deux galants enrubannés qui leur promettent gloire et amour. Mais horreur! Les seconds ne sont que les valets des premiers. Chacun est renvoyé à sa superficialité, dans un final délirants où ne sont épargnés ni les maîtres éconduits, ni les précieuses humiliées, ni les valets ridiculisés. À grands coups d'irrésistibles «ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras », Molière amorce, avec Les Précieuses Ridicules, la synthèse de la farce française et de la comedia dell'arte italienne, recrée les archétypes de la comédie et s'affirme comme le génial observateur de son temps.
Avec Les Précieuses Ridicules, Paul Buissonneau signe pour une première fois la mise en scène d'un texte de Molière.
Texte
MolièreMise en scène
Paul BuissonneauAvec
France Arbour - MAROTTE
Valérie Blais - CATHOS
Stéphane Breton - MASCARILLE
Pierre Collin - GORGIBUS
Sylvie Drapeau (remplacée par Marie-France Lambert) - MAGDELON
René Gagnon - DU CROISY
Claude Gai - ALMANZOR
Jean Marchand - LA GRANGE
Denys Paris - JODELETDu 21 octobre au 15 novembre 2003
par David Lefebvre
Il est inutile de vous faire une grande description ici de l'auteur; tout le monde connaît Molière, d'une façon ou d'une autre. Patron de la comédie française, on le nomme avec Shakespeare parmi les auteurs ayant marqué le monde du théâtre. Le dramaturge anglais écrivait des drames, des tragédies, tandis que Molière, pour passer son message, préférait le rire et les larmes.
Les Précieuses riducules est sa troisième pièce. C'est celle qui lui a donné une certaine notoriété dans Paris. Présentée «en baisser de rideau», c'est-à-dire à la suite d'une autre pièce (à sa première, le 18 novembre 1659, voilà près de 344 ans (!), c'était après Cinna de Corneille) elle sera reprise par la suite et connaîtra un certain succès mais elle attirera les foudres et réactions hostiles, dont celles du chroniqueur Somaize, auteur du Dictionnaire des précieuses.
C'est d'ailleurs comme ça que la pièce "débute". Comme le rideau est levé, nous voyons marcher les comédiens, et sur un rideau imprimé aux visages d'acteurs ayant incarnés certains personnages de Molière dans le passé, et avec musique de clavecin, on peut lire de petites critiques sévères sur Molière et sa pièce Les Précieuses ridicules. Aujourd'hui, cela fait bien rire, parce que malgré tout, Molière est encore joué et acclâmé partout...
Cathos (Valérie Blais) et Magdelon (Marie-France Lambert), jeunes précieuses de province, ne supportent que la fréquentation de beaux esprits. Gorgibus (Pierre Collin), père de l'une et oncle de l'autre, veut les marier à de jeunes gens qui ont de la fortune et un titre de noblesse, et encourage donc La Grange (Jean Marchand) et Du Croisy (René Gagnon) à leur faire la cour. Vertement repoussés par les jeunes femmes, ils laissent entendre à Gorgibus qu'ils ont été mal reçus. Lorsqu'elles exposent par la suite leur idéal de galanterie et leur vision romanesque du mariage, Gorgibus, outré, leur promet de les marier de force à qui il voudra. Effrayées de cette perspective, les précieuses se désolent de leur sort injuste, quand on annonce deux visiteurs : le premier, «marquis de Mascarille» (Stéphane Breton), fait à Magdelon et Cathos des compliments qui les ravissent (surtout à la première), et leur lit un poème de sa composition; le second, «vicomte de Jodelet» (Denys Paris), ami de Mascarille que celui-ci présente comme un héros, se vante d'exploits militaires fictifs. Impressionnées par la belle prestance et la galanterie de ces visiteurs, Cathos et Magdalon font venir des musiciens et un bal commence. Arrivent alors La Grange et Du Croisy qui révèlent la véritable identité des faux galants (étant leurs laquais). Les deux précieuses doivent subir la colère de Gorgibus, en plus d'être mortifiées d'avoir été ainsi trompées.*
Ce qui est intéressant avec Molière, à part les farces, c'est que ses textes deviennent de véritables fenêtres sur la cultures et les moeurs de son époque. Les mariages arrangés, et ici la venue de l'amour romanesque, et ces fameuses précieuses. Prenons un instant pour expliquer ce que c'est. La préciosité se développe dans le cercle de la marquise de Rambouillet, dont le salon réunit, à partir de 1625, quelques-uns des beaux esprits de Paris; là s'élabore un code de conduite et de pensées qui vise à raffiner le goût. Les femmes y sont révérées et courtisées avec beaucoup de déférence par des gentilhommes prêts à tout pour se montrer dignes de celles qu'ils «aiment». La virtuosité dans la conversation et la maîtrise de l'expression poétique joue un rôle primordial dans cette société où il est essentiel de briller par son esprit. Ce mouvement se base sur l'impératif de raffinement : du langage, qui évite les mots «bas» ou «ordinaires» au profit d'un vocabulaire recherché ; de la mise et du costume et des sentiments, qui doivent également s'abstenir de toute bassesse et de toute vulgarité.* Face à cette mode, Molière a donc écrit une farce, une satire des plus corrosive. Le texte est indéniablement savoureux, jouant avec les métaphores, riant des jeux de mots et tournures de phrases des plus ridicules pour faire «savant» et du fameux poème «Au voleur!» des plus rigolos scandé par le marquis de Mascarille.
Confier ce texte à Buissonneau était tout indiqué. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pièce est le premier Molière qu'il monte. Parce que ce géant de la comédie se méfie comme de la peste des comédies faciles. Faire rire pour faire rire, non merci. Mais heureusement, Molière a assez de génie pour satisfaire Buissonneau.
Crédit photo : Yves Renaud photographe
Valérie Blais, Stéphane Breton, Marie-France LambertSatirique, piquant, le texte est drôle parce que les comédiens le sont. Et ici nous sommes servis. Marie-France Lambert, qui pourtant n'est arrivée dans l'équipe que depuis peu, campe parfaitement une Magdelon pleine d'esprit. Valérie Blais est excellente en Cathos d'une naïveté déconcertante et Stéphane Breton joue entre le clown de service, le personnage d'émission pour enfant et un Arlequin savant, mais avec brio. Les petits détails, trouvés par l'équipe et Buissonneau, rendent les personnages des plus attachants (comme ce petit rire saccadé de Marie-France Lambert). Les costumes (de Ginette Noiseux), soient réalistes et de bon goût (pour les serviteurs, les maîtres et les jeunes dames (magnifiques robes, qui définissent parfaitement le tempérament et l'esprit de celles qui les portent) soient «exagérés» (dont celui du marquis, avec un espère de chapeau melon et un costume à rayures et rubans) sont magnifiques. Le décor semble sortir tout droit du 17e siècle, bien trouvé, dessiné et savamment orchestré. À gauche et à droite se tiennent les serviteurs (dont l'homme fait semblant de s'occuper de la musique de la pièce aves des bobines magnétiques) et au milieu, sur une scène surélevé et derrière le fameux rideau aux visages, se trouve la chambre des jeunes dames, aux multiples miroirs. L'éclairage rend la scène chaleureuse, et viendra appuyer ce long monologue à la fin de Gorgibus (Pierre Collin), inventé par le metteur en scène.
Parlons-en de cette fin. Tiré de l'oeuvre de Molière et des commentaires et des citations, elle veut donner une vision plus large et un éclairage différent de la pièce. Malgré le bon vouloir, le texte se perd et nuit à la bonne compréhension. Tout à coup, Gorgibus parle de ses serviteurs, qu'il a tout perdu, puis de sa femme, qu'il est cocu et ainsi soit-il. Un peu long, ce texte vient ajouter une fin encore plus tragique à la pièce, qui aurait pu arrêter bien avant. Un petit bémol mais qui, heureusement, n'enlève rien au bonheur et au plaisir que nous avons eu en assistant à la pièce.
Un petit spectacle (1h15), entre la comedia dell'arte et la farce, qui nous fait grandement sourire et rire et qui nous montre encore une fois tout le génie de Molière (et des comédiens et concepteurs d'ici).
*Tiré et inspiré des textes du programme du spectacle