
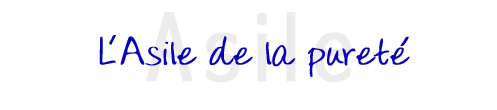
Quel sens donner aux tragédies quotidiennes? Que peut-on opposer à la disparition de l'être aimé, au pouvoir opressant de la majorité, à la censure, la lâcheté, sinon l'importance de la liberté? Pour garder intacte la mémoire et la dignité de la femme qu'il aimait et qui vient de mourir (sa muse), le poète Donatien Marcassilar s'astreint à un jeûne qu'il désire poursuivre jusqu'à l'épuisement final. Dès lors, une foultitude de personnages entrent en scène et s'agitent autour du grabat du contestataire, soit pour l'encourager dans son projet, soit pour l'en dissuader, chacun agissant selon ses propres motifs et intérêts. Sous les assauts des bouffons du pouvoir, de tous les pouvoirs, le poète ira au bout de son idéal, sans dévier. Porté par une écriture d'où surgissent toutes les libertés, Gauvreau signe un texte qui reflète son engagement total pour son art, sa lutte et sa vision de l'existence. L'Asile de la pureté le met directement en scène, dans cette «étude sur la mesquinerie, la lâcheté, la manipulation, l'intégrité de la passion et les jeux de la bourgeoisie bien-pensante.»
 Texte
de
Texte
de
Claude Gauvreau
Mise en scène de
Lorraine Pintal
Avec
Carl Béchard : Croufandié, Eudes Levert
Marc Béland : Marcassilar
Annie Berthiaume : Catherine Tayet
Vincent Bilodeau : Portier-Béchin, Cyrano de Bergerac
Estelle Clareton : Édith Luel, Jane Rameau
Frédéric Desager : Abraham de Turelure, Amable George
Brigitte Lafleur : Junie
Alexis Martin : Fortunat Leswick
Éric Paulhus : Fabrice Sigmond
Dominic Théberge : Luc-Albert
Marthe Turgeon : Irène
Du 10 février au 6 mars 2004


par David Lefebvre
Colle à moi tes rebus de charme...
Il y aurait tant de choses à dire et à écrire ici à propos de Claude Gauvreau, de ses oeuvres, de son impact sur la culture québécoise, qu'il serait folie de croire d'y arriver en quelques lignes. Pour tout de même se mettre en contexte, voici quelques lignes sur ce grand homme longtemps étiquetté comme «poète maudit».
Claude Gauvreau est né à Montréal le 19 août 1925 (et décédé en tombant du toît de sa résidence le 7 juillet 1971). Poète et dramaturge, Claude Gauvreau fait ses études au Collège Sainte-Marie et à l'Université de Montréal où il obtient un baccalauréat en philosophie. Farouche défenseur de l'art moderne et ami d'Émile Borduas, il devient membre actif du mouvement automatiste en 1946 et signe le fameux manifeste Refus global en 1948. En 1949, il signe un livret d'opéra, Le Vampire et la Nymphomane, puis en 1951 un recueil de poèmes abstraits, Étal mixte. Critique de théâtre à l'hebdomadaire Le Haut-Parleur, Claude Gauvreau, suscite bien des polémiques ; il collabore également à de nombreux périodiques dont Le Quartier latin, Notre temps, Parti-pris, Liberté, Le Canada, Situations, Le Petit Journal, L'autorité du peuple et La Barre du Jour en 1969, pour le numéro portant sur Refus global. Il a aussi écrit de nombreuses pièces radiophoniques et participé à des récitals de poésie. C'est en 1952 que sa «muse», Muriel Guilbault, se suicide.
Il écrit L'Asile de la pureté en 1953, peu après son roman Beauté baroque, qui évoque son amour pour Muriel Guilbault. Comme à peu près toutes ses oeuvres, cette pièce est autobiographique. Voici un bref résumé de l'histoire : pour garder intacte la mémoire et la dignité de la femme qu'il aimait et qui vient de mourir (sa muse), le poète Donatien Marcassilar s'astreint à un jeûne qu'il désire poursuivre jusqu'à l'épuisement final. Dès lors, plusieurs personnages entrent en scène et s'agitent autour du grabat du contestataire, soit pour l'encourager dans son projet, soit pour l'en dissuader, chacun agissant selon ses propres motifs et intérêts.
Le texte soulèvent énormément de questions : qu'est-ce que la folie? Jusqu'où nos actes profitent-ils à d'autres? Quelle importance a la liberté dans la création? Jusqu'où peut-on aller pour nos propres convictions? Ces questions et bien d'autres sont évoquées directement et indirectement dans le magnifique texte de Gaudreau, mis en scène par Lorraine Pintal. Elle a d'ailleurs un certain penchant pour cet auteur, sinon une connection incroyable, puisqu'elle a aussi monté Les Oranges sont vertes en 1998. J'ai eu la chance de voir une ébauche, une sorte de lecture lors du dernier FTA, de L'Asile de la pureté. Comme je n'avais pu voir le tout, j'étais très curieux d'assister au projet final et de connaître le reste de l'histoire.
Ce qui frappe au départ, c'est la conception scénique : pour accentuer l'effet d'opression, les spectateurs sont tout le tour de la scène, c'est-à-dire qu'on a monté une estrade derrière et sur les côtés de la scène. Donc en ce sens, la scène ne se limite plus à ses frontières traditionnelles mais déborde dans la salle. Parsemée de fleurs, on se retrouve sur scène en présence de Croufandié (Carl Béchard), Catherine Tayet (Annie Berthiaume), Portier-Béchin (Vincent Bilodeau) et Fortunat Leszwick (Alexis Martin) auteurs et amis d'Édith Luel (Estelle Clareton), qui est tombée dans la mort, et de Donatien Marcassilar (Marc Béland) . Ils discutent au cimetière, juste avant l'enterrement de la belle, à savoir à qui et comment profitera cette mort et si Donatien se présentera malgré sa maladie et la peine qu'il tente de tuer. D'entrée de jeu, on comprend les magouilles, les manipulations... Mais tout de suite, Marc Béland nous offre un jeu splendide, un Marcassilar triste à mourir, une blessure ambulante. Il a perdu ce à quoi il tenait le plus au monde et on y croit. Il décide donc de ne plus manger. Et il sait très bien que c'est mourir à petit feu. Et pourquoi pas? Tout ce qui pourrait arriver de fâcheux, c'est d'aller rejoindre Estelle.
Mais ses amis ne le prennent pas ainsi. Au fil de temps, on s'aperçoit le tort que tout cela fait sur la famille immédiate, puis le mouvement révolutionnaire qui se lève chez la jeunesse québécoise et qui encourage cette nouvelle icône de protestation. Mais que veut dire tout ceci au fond? Ceux qui sont contre prendront donc les grands moyens pour le faire manger. Mais si le faire manger, après tant de temps, le faisait mourir?
Avec une mise en scène en finesse, adaptée au texte de Gauvreau, Lorraine Pintal signe ici une oeuvre qui se regarde avec joie et nous plonge littéralement dans l'univers de ce grand poète. Par cette musique d'inspiration religieuse (orgues, cloches, chants grégoriens) on se replonge dans les années 50-60 : là où l'omniprésence de la religion empêche la libre création. Mis à part quelques personnages (très peu) ils sont tous vêtus de blanc ou de couleur crème. D'ailleurs, les costumes de Marie-Chantale Vaillancourt sont magnifiques (surtout, je dois dire, celui d'Alexis Martin). Les éclairages sont francs, ou indirectes (allant alors chercher des teintes de bleu surtout lors de moments d'hallucinations de Marcassilar).
Mais cette pièce aurait pu devenir un véritable fiasco si les comédiens n'avaient pas été à la hauteur. Tous et toutes sont excellents, nous faisant sentir chaque mot de Gauvreau tout au creux de notre tête et de notre coeur. Béland donne une prestation incroyable, la présence d'Alexis Martin est magnifique, tout comme celle de Vincent Bilodeau. Le seul tout petit hic (s'il faut en trouver un) est l'intonation un peu traînante de Marthe Turgeon, qui interprète la mère de Donatien. Mais ici ce n'est qu'affaire de goût, et son jeu est tout aussi bon que les neuf autres comédiens.
On a même droit à quelques pas de danse (moderne) de la part d'Estelle Clareton et Marc Béland, ce qui n'est pas du tout déplacé, puisque nous sommes à ce moment dans un rêve, une hallucination, quand Édith se présente à Donatien. Toute l'ambiance par après rappellera (par la musique et les mouvements) celui d'un cirque, noir. Puis dans la deuxième partie, le lit (puisqu'on se trouve depuis le début dans la chambre de Marcassilar) est remplacé par un bain, et les symboles de pureté (jeûne, séparation des idées, eau) se succèdent.
Le rythme est bon, soutenu. L'ambiance est aérée, pour donner comme une impression de rêve, d'irréalité. Très esthétique et poétique, les amateurs de théâtre classique ne trouveront peut-être pas leur compte, puisque le texte peut paraître parfois illogique, ou du moins on peut se sentir perdu dans le flot de mots. Mais on a qu'à se laisser bercer par la sonorité et l'émotion nous portera doucement. Nous avons même droit à certaines visites surprenantes dans le texte, dont Cyrano de Bergerac et un Don Quichotte repenti, ainsi que l'auteur lui-même, décidant de ce qui va se passer avec ses personnages, tel un dieu qui dirigent des marionnettes qui n'en font qu'à leur tête. Pour ce faire, deux télés diffusent des images de Gauvreau.
À voir, pour le jeu des acteurs, la poésie de Gauvreau et le poème abstrait (Les 3 suicides d'Ocgdavor Pithuliaz) que Marc Béland réussit à jouer avec vraisemblance et naturel. Époustouflant.